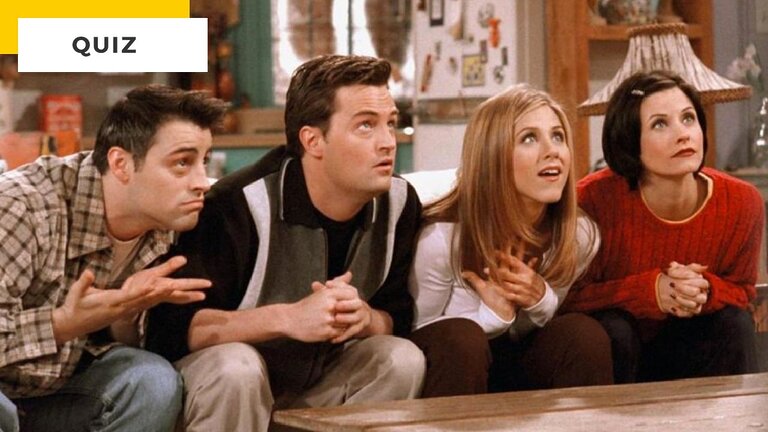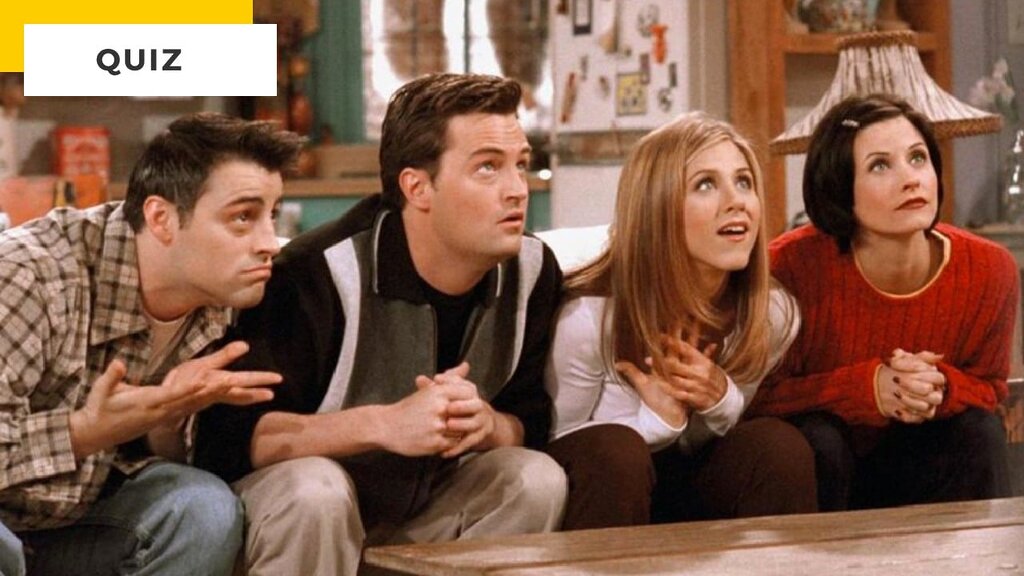Suite de notre série de quiz Friends ! Nous en sommes déjà à la saison 4 avec huit questions pointues sur les différents évènements des vingt-quatre épisodes.
C’est donc un nouveau quiz sur la série Friends que nous vous proposons aujourd’hui, entièrement centré sur la quatrième saison de la célèbre sitcom américaine. Avant de nous jeter dans le bain, petit retour sur la saison précédente, et notamment sur les différentes histoires d’amour qui ont pu émailler la vie des six personnages principaux.
Et commençons par LA relation centrale de la série, celle, bien entendu, de Rachel et Ross. Si au début de la saison, durant quelques épisodes tout semble être au beau fixe, les choses vont vite commencer à se gâter lorsque Rachel dégote un nouveau travail chez Bloomingdale’s grâce à un certain Mark. Outre le fait que ce nouveau job semble de plus en plus l’accaparer, Ross commence à se montrer jaloux et un poil envahissant. Rachel décide alors de faire une pause (la fameuse ! ) et Ross sort donc avec la fille de la photocopieuse Chloé. Se pose alors LA question centrale de leur relation : Ross a-t-il trompé Rachel alors que « They were on a break ! » ? S’en suit en tout cas une explication houleuse dans le salon de l’appartement à laquelle assiste les quatre amis depuis la chambre voisine.
Quiz Friends : la toute dernière question pourrait vous priver du Perfect !Suite de notre série de quiz Friends ! Nous en sommes déjà à la saison 4 avec huit questions pointues sur les différents évènements des vingt-quatre épisodes.
Dans le premier épisode de la saison, lequel de ces personnages se fait piquer par une méduse ?Dans l’avion qui la mène au mariage de Ross, Rachel se confie à un acteur ayant incarné un autre héros de série bien connu du grand public. Lequel ?
Dans l’épisode 3, contre quoi Joey et Chandler échangent-ils leur télévision ?
Lors du pari entre les garçons et les filles, à quelle question les filles ne savent pas répondre, leur faisant perdre leur appartement ?
Quel est le prénom de ce personnage avec qui Ross entretient une courte relation durant l’épisode 6 ?
Durant l’épisode 18 on apprend que Phoebe est enceinte, mais à qui va-t-elle bientôt donner naissance ?
Dans l’épisode 14, Joey doit tourner avec un célèbre comédien dont il emprunte la douche de sa loge. Qui est-ce ?
Question technique pour terminer : combien de pages fait la lettre que Rachel donne à Ross dans le premier épisode de la saison ?
Il faudra bien un gros câlin pour vous consoler…Les applaudissements de Ross pour ce joli score !
8/8 ! Aucun doute, vous êtes vraiment fan de Friends !
Monica, de son côté, après une courte relation avec un certain Julio, renoue un temps avec Richard, l’ophtalmologue ami de ses parents, avant d’entamer une nouvelle histoire, un peu plus longue celle-ci avec le millionnaire Pete Becker, idylle qui prendra fin à cause de son penchant trop prononcé pour l’ultimate fighting. Chandler, lui, remet le couvert avec Janice dont il semble étonnamment amoureux avant de rompre à nouveau lorsque celle-ci revoit son ex-mari. Joey, d’habitude bourreau des cœurs sans attache, connait lui aussi sa courte romance avec Kate, une actrice de sa nouvelle pièce de théâtre. Quant à Phoebe, elle papillonne, allant même jusqu’à avoir une double relation à la fin de la saison.D’amour il sera aussi question dans ce quiz sur la quatrième saison, mais pas que, comme vous pourrez le constater en tentant de répondre à ces huit questions.